XVIIIe siècle
-
-
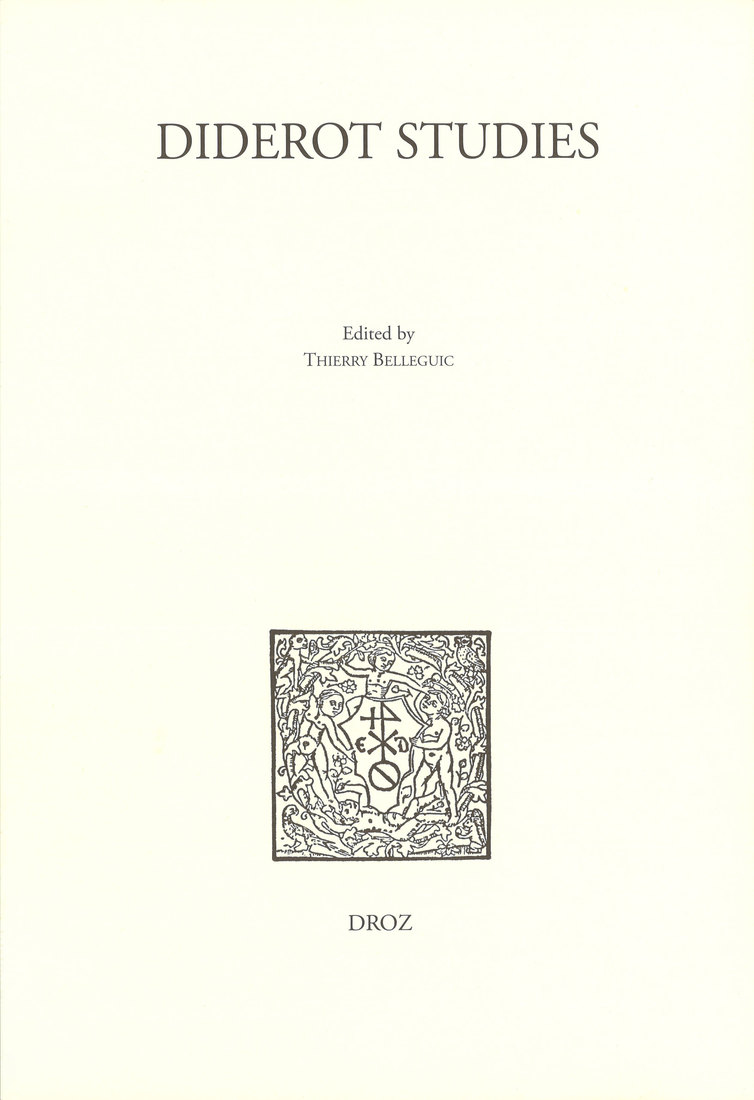
Table des matières : B. HOFFMANN, « Introduction » – La postérité dans l’œuvre de Diderot – O. RICHARD, « Diderot et les images de la postérité » ; F. CHASSOT, « Diderot et les apophtegmes, ou la postérité revue et corrigée » ; R. LE MENTHÉOUR, « La Postérité pour quoi faire ? Diderot, Falconet, Rousseau » ; T. BOON CUILLÉ, « Respect for Posterity, ou de ce qui n’est pas » ; F. LOTTERIE, « Étouffée en naissant ? La négativité de la postérité dans La Religieuse » ; E. RUSSO, « Diderot and the Perils of a Russian posterity ». – L’Encyclopédie et la Postérité – V. LE RU, « Diderot et l’Encyclopédie ou la conscience aiguë de la postérité » ; C. FAUVERGUE, « La postérité, la sphère des connaissances et l’Encyclopédie à venir ». – Postérité de Diderot – O. TONNEAU, « Diderot’s Bare Face. Morals, Materialism and Le Neveu de Rameau » ; G. BORNANCIN-TOMASELLA, « Reforming the Theatrical Stage. Nerval, Reader and Continuator of the Entretiens sur le Fils naturel » ; L. MALL, « Fatras et fracas. La postérité de Diderot par le filtre de Barbey d’Aurevilly dans Goethe et Diderot » ; F. CHAMPY, « Diderot, Eisenstein, and the Paradoxes of Visual Culture » ; G. COISSARD, « Diderot, les new materialisms et la vie de la matière ».
Table des matières : B. HOFFMANN, « Introduction » – La postérité dans l’œuvre de Diderot – O. RICHARD, « Diderot et les images de la postérité » ; F. CHASSOT, « Diderot et les apophtegmes, ou la postérité revue et corrigée » ; R. LE MENTHÉOUR, « La Postérité pour quoi faire ? Diderot, Falconet, Rousseau » ; T. BOON CUILLÉ, « Respect for Posterity, ou de ce qui n’est pas » ; F. LOTTERIE, « Étouffée en naissant ? La négativité de la postérité dans La Religieuse » ; E. RUSSO, « Diderot and the Perils of a Russian posterity ». – L’Encyclopédie et la Postérité – V. LE RU, « Diderot et l’Encyclopédie ou la conscience aiguë de la postérité » ; C. FAUVERGUE, « La postérité, la sphère des connaissances et l’Encyclopédie à venir ». – Postérité de Diderot – O. TONNEAU, « Diderot’s Bare Face. Morals, Materialism and Le Neveu de Rameau » ; G. BORNANCIN-TOMASELLA, « Reforming the Theatrical Stage. Nerval, Reader and Continuator of the Entretiens sur le Fils naturel » ; L. MALL, « Fatras et fracas. La postérité de Diderot par le filtre de Barbey d’Aurevilly dans Goethe et Diderot » ; F. CHAMPY, « Diderot, Eisenstein, and the Paradoxes of Visual Culture » ; G. COISSARD, « Diderot, les new materialisms et la vie de la matière ».
-
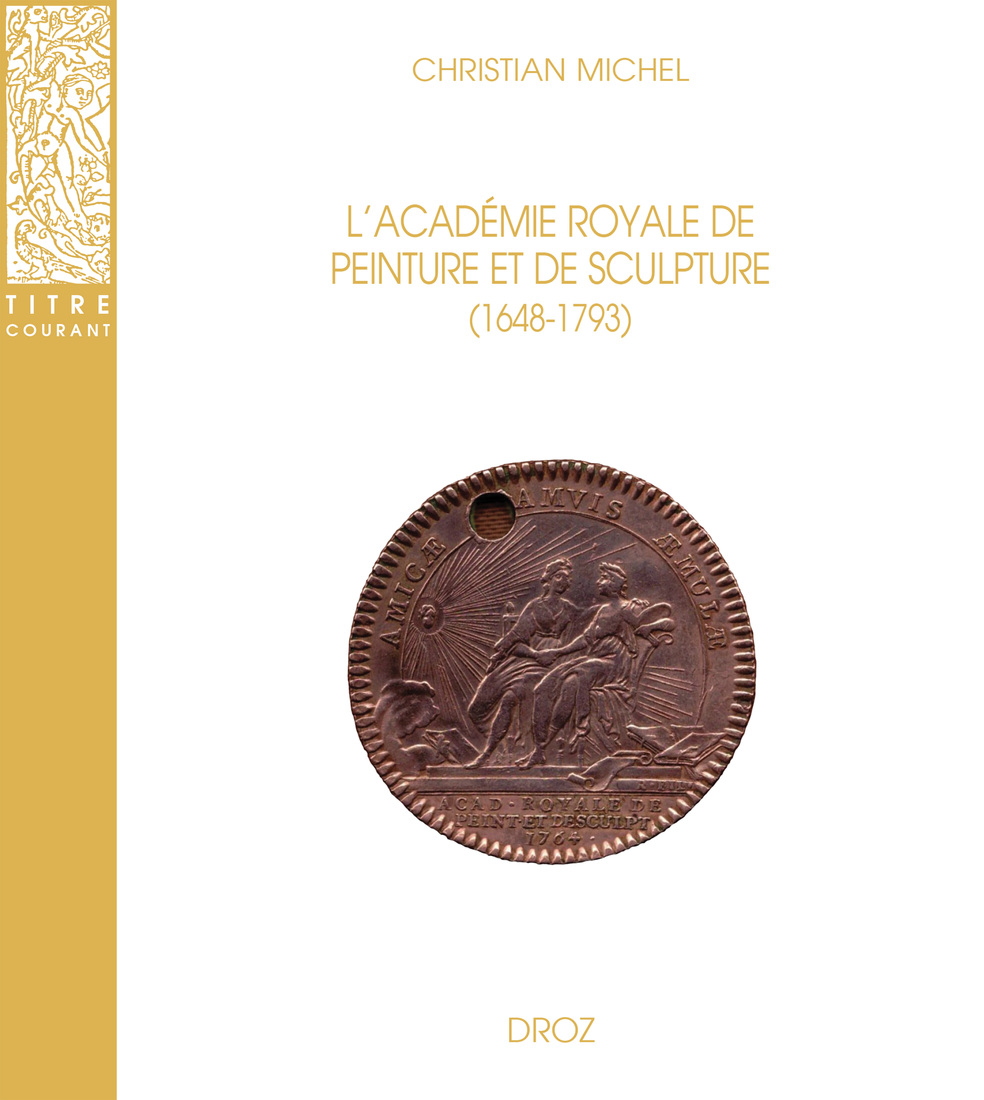
L’Académie royale de Peinture et de Sculpture a régi les arts en France pendant un siècle et demi. Or l’institution demeure largement méconnue et continue d’être présentée aujourd’hui encore en fonction des discours, élogieux ou critiques, qui ont été portés sur elle, tant durant son existence que depuis sa suppression.
Christian Michel fait son histoire et en retrace l’évolution à l’aune des rapports de pouvoir et des querelles de goût qui agitèrent la société française entre 1648 et 1793. Une histoire de l’Académie permet en effet d’apprécier la définition de l’art qu’elle mit en œuvre sous l’Ancien Régime. Sont successivement étudiés les conditions de sélection de ses membres, la façon dont elle construisit sa réflexion sur l’art et comment elle enseigna celui-ci, la fonction des Salons, l’élaboration des critères de fabrication pour qu’une pièce, d’objet manufacturé, pût être élevée au statut d’œuvre d’art, les effets économiques et sociaux qu’eut, pour les artistes, l’appartenance au corps et, enfin, la place que l’Académie tint dans le système des arts en France et en Europe.
Si l’histoire sociale et politique est interrogée par ce livre, son principal enjeu relève de l’histoire de l’art : il entend montrer comment la production artistique a été marquée par l’Académie.
-
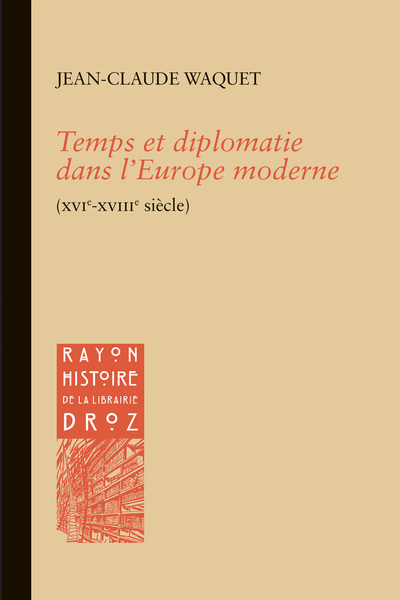
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
Introduction
PREMIÈRE PARTIE:
LA DIPLOMATIE EN SON TEMPS
Chapitre premier.
Comment on écrira l'histoire du temps de la diplomatie
Les sources et leur apport
Les temps de l'histoire du temps
Le temps de la bibliographie
Les temps des « International Relations » et des « Negotiation Studies »
Du particulier au général
Les termes de l'enquête
Chapitre II.
Temporalités hétérogènes et présents inattendus
La temporalité de la diplomatie:
Complexité et conflit
Perméabilité et hétérogénéité
Le présent de la diplomatie
Inattendu, incertitude, précarité
La marge de manoeuvre temporelle des acteurs
Chapitre III.
Puissance, Confiance, Prudence : les négociateurs à l'épreuve des temps
Temporalités des négociations et marge de manoeuvre des acteurs : les marchandages entre Florence et Vienne
L'arme des faibles
Le triomphe des forts
Confiance dans le futur et maîtrise des temps : la France et l'Espagne face aux négociations, de la paix de Cateau-Cambrésis à la guerre de Trente ans
Le mirage de la prudence : La Chétardie et les révolutions de Saint-Pétersbourg
Manipulation des temps et construction de l'événement
Manipulation narrative et reconstruction de l'événement
DEUXIÈME PARTIE:
LE TEMPS DE L'AMBASSADEUR GUILLERAGUES
Chapitre IV.
Philarque chez les Turcs
De Bordeaux à Constantinople : la réussite, mais à crédit
L'Empire ottoman : altérité, commensurabilité, opportunités
Une ambassade au croisement des espaces-temps
Les lettres sérieuses d'un mondain devenu ambassadeur
Chapitre V.
Naviguer entre les temps : la temporalité de l'ambasadeur Guilleragues
La pluralité des temps
L'enchevêtrement des temps
Chapitre VI.
Voir le futur : des nouvelles aux pronostics
Des nouvelles du futur
Les fondements de l'interprétation
La fabrique des apparences
D'une apparence à l'autre : l'histoire devant soi
Un futur sans avenir ni intrigue
Chapitre VII.
Agir selon l'à-propos. I. La production du futur
Un préalable : les conditions d'exercice de l'à-propos
Le temps des échanges et les débuts difficiles de l'affaire du sofa
Reprendre la maîtrise du temps : le levier du futur et l'épreuve du présent
Le bombardement de Chio : de la préemption de l'avenir à la recomposition de la temporalité
Réécriture des futurs, croissance des risques et reclassement des temps
L'impossible maîtrise des temps des affaires
La marge de manoeuvre temporelle et ses risques
Après Chio : le temps du patronage, menacé et sauvé
La maîtrise perdue, puis retrouvée, du temps de l'affaire du sofa
Remarques finales
La conquête du futur et les épreuves du présent
Une pratique conflictuelle des temps
Chapitre VIII.
Agir selon l'à-propos. 2. La production du passé
Août 1681 : le récit crée l'événement
Les négociations d'octobre : le temps du récit au service de l'apologie et de la justification
Les variations du temps raconté
Du récit apologétique au récit glorieux
Amis et ennemis
La conclusion de l'affaire de Chio et la relance de la compétition narrative
Conclusion
Souci du futur et histoire devant soi : l'expérience temporelle des négociateurs
Entre imaginaire, expérience et figuration : les trois faces du Temps de l'ambassadeur Guilleragues
Sources et Bibliographie
Sources manuscrites et imprimées
Bibliographie
Index des noms de personnes
Index des noms de lieux
L’histoire du Temps de la diplomatie à l’époque moderne est celle de l’enchevêtrement de ses praticiens dans un dédale de temps désaccordés dont l’horloge, symbole de la modernité, n’était pas le grand régulateur. Elle montre comment ces personnages anxieux de percer l’opacité du futur, familiers des pronostics, mais aussi exposés au dévoilement de l’histoire, faisaient des temps, manipulés ou racontés, une ressource de leur action et l’un des moyens de réaliser leurs fins. Son objet est ainsi l’être au temps et le faire avec les temps de ceux qui étaient dépêchés au loin, et spécialement de Guilleragues, ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, qui tient ici le rôle principal. À travers lui et quelques autres, l’univers temporel des acteurs de la diplomatie se trouve restitué, et la diplomatie de l’âge moderne revisitée à partir d’une de ses dimensions les plus essentielles, négligée jusqu’à présent par l’historiographie.
-
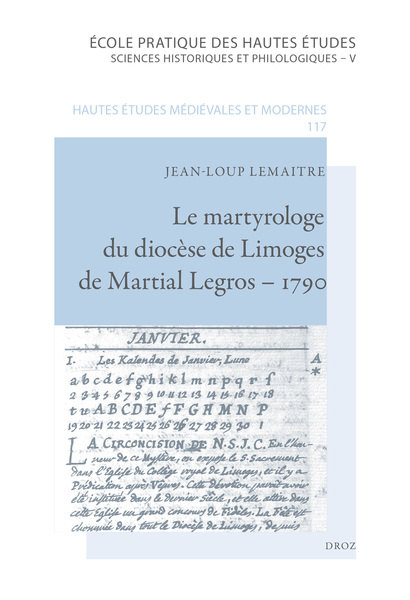
En 1790, Martial Legros (1744-1811), prêtre et bénéficier de Saint-Martial de Limoges, met la dernière main à la rédaction de son martyrologe du diocèse de Limoges, qui fait en quelque sorte la synthèse des travaux d’hagiographie limousine compilés depuis des années : Vies des saints du diocèse de Limoges, Supplément aux vies des Pères pour les saints du diocèse de Limoges. Il a fait partie de la commission mise en place à partir de 1758 par l’évêque Louis-Charles Du Plessis d’Argentré pour la refonte de la liturgie du diocèse, aboutissant notamment à la rédaction d’un nouveau bréviaire en 1783. Legros donne bien sûr les éloges des saints à leur jour de célébration, rédigés en français, mais avec toutes les variantes selon les églises, fêtes et translations, y ajoutant de nombreuses dédicaces d’églises ou même d’autels qui ne sont pas connues autrement.
On se rend compte à sa lecture de la diversité du culte des saints au cœur d’un même diocèse au fil des années, d’un culte qui n’est pas figé comme on pourrait le croire à la lecture du martyrologe romain. On a dans ces pages le résumé de neuf siècles d’hagiographie limousine, telle qu’elle était vécue par les fidèles.
-

Table of contents / Table des matières : V. Sperotto, « Introduction » – Diderot et le scepticisme – P. Quintili, « Scepticisme, matérialisme et athéisme : une triade problématique, à partir de Diderot » ; S. Giocanti, « Diderot philosophe antidogmatique et sceptique ? » ; M. Spallanzani, « Diderot : scepticisme et encyclopédie. “Qu’est-ce qu’un sceptique ?” » ; M. Mazzocut-Mis, « Diderot se promène : de La promenade du sceptique à La promenade Vernet » ; V. Sperotto, « Jacques le fataliste et son maître ou les détours sceptiques du roman » ; J.-P. Cléro, « Le pour et le contre. Diderot est-il sceptique ? » ; G. Paganini, « Comment dépasser le scepticisme : l’influence de Diderot sur les Dialogues sur la religion naturelle de David Hume » – Varia – F. Chassot, « Diderot contre Falconet : action et création dans les Lettres sur la postérité » ; C. de Courson, « Les amis inconnus de Diderot, ou la fabrique du lecteur à venir » ; P. Pellerin, « L’image de Diderot dans les Mémoires de Marmontel » ; I. Mullet-Blandin, « À la rencontre du corps de l’autre, La lettre sur les aveugles de Diderot » ; S. Charles, « Les fils naturels de Dorval et de Grandison : les leçons de la réécriture » ; A. Paschoud et B. Selmeci Castioni, « L’allégorie chez (le jeune) Diderot : une figure colossale ? » ; R. Chalmin, « Misologie des Lumières » – Index nominum.
-

TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Avertissement
Abréviations
Introduction
Typologies et études de cas
Les pièces d’apparat et les résidences : modèles artistiques, modèles politiques ?
Vers une approche comparative européenne de l’escalier d’honneur
Première partie
UTILITÉ ET SPLENDEUR
Chapitre premier
Les fonctions de l’escalier d’honneur
L’accès principal à l’appartement du prince
Les pièces desservies par l’escalier d’honneur
Le placement de l’escalier d’honneur et sa visibilité
Forme des rampes et distribution
Un lieu clé du cérémonial européen
Entrées princières, audiences, fêtes et divertissements
Un accès réglementé au quotidien
Chapitre II
L’escalier d’honneur et les contraintes des bâtiments princiers
La typologie complexe des édifices princiers
Des appellations aux contours flous
L’appropriation d’un édifice : des changements de statut et d’usages d’un souverain à l’autre
Anciens et nouveaux bâtiments
Incarner le passé dynastique
L’escalier d’honneur, une pièce importante dans les nouveaux édifices
Deuxième partie
L’ESCALIER D’HONNEUR ET LA MAGNIFICENCE PRINCIÈRE
Chapitre III
Dépense, noblesse des matériaux et convenance
Des chantiers longs et coûteux
Origines et modalités de financement
La répartition du coût des escaliers entre le gros œuvre et la décoration
L’approvisionnement des matériaux
Entre ressources naturelles du territoire et importations : marbre, pierre, stucs
Le problème des marches
Une splendeur convenable : la gradation de l’effet de richesse dans l’appartement princier
Peinture et sculpture
Architecture feinte et quadrature : l’illusion de l’espace
Chapitre IV
Des sujets dignes d’un prince : les choix iconographiques et leurs enjeux
L’universalité de la fable et de l’allégorie : convenance et allusions politiques
Le règne d’Apollon et l’assemblée des dieux : des thèmes privilégiés de la Fable autour de 1700
L’Énée bavarois et les ambitions impériales des Wittelsbach dans les années 1720
Les amours d’Alexandre dans l’escalier de Fontainebleau au lendemain de la guerre de succession d’Autriche
L’allégorie comme élément de distinction
Représenter l’histoire d’un règne ou d’un État : l’apanage de la souveraineté
Versailles et Madrid : continuités et ruptures dynastiques
Une souveraineté éphémère : les princes ecclésiastiques germaniques et le modèle iconographique royal
Le portrait du prince pour accueillir le visiteur : entre dimension mémorielle et magnificence
Portraits de rois
La singularité de l’Empire
Troisième partie
PERSPECTIVES DYNASTIQUES : ÉCHANGES, ADAPTATIONS ET APPROPRIATIONS FAMILIALES
Chapitre V
Les escaliers des Wittelsbach : la constitution d’un modèle dynastique ?
Max Emanuel et Joseph Clemens de Bavière : deux frères bâtisseurs
Avant l’exil, un architecte en commun : Henrico Zuccalli
Le retour d’exil et la concrétisation des projets
Schleissheim : une référence familiale dans les années 1720
Les escaliers de la résidence de Munich et du château de Brühl
La branche du Palatinat : l’électeur Karl Philipp et l’escalier de la résidence de Mannheim
Chapitre VI
Les escaliers des Schönborn : des enjeux diplomatiques
Lothar Franz von Schönborn, Leonhardt Dientzenhofer et les premiers escaliers des Schönborn
Autour de 1700 : les premiers essais à Bamberg et Gaibach
L’invention de l’escalier du château Weissenstein à Pommersfelden dans la décennie 1710
Les escaliers de Balthasar Neumann pour les neveux de Lothar Franz (vers 1730-vers 1750)
Würzburg : la reconnaissance des compétences de Balthasar Neumann et l’expression de la réussite familiale
Les escaliers de Balthasar Neumann au service des ambitions diplomatiques des Schönborn
Chapitre VII
Les escaliers des Bourbons d’Espagne : une recherche de variété
Les escaliers d’Aranjuez et de Riofrío sous Philippe V et Ferdinand VI : l’adaptation de projets non exécutés pour le palais royal
Aranjuez, de Carlo Pedro Idrogo à Santiago Bonavia : un changement radical
L’escalier du Riofrío : une alternative à l’escalier du palais royal
De l’Italie à l’Espagne : l’escalier selon Charles III
Luigi Vanvitelli et le succès de Caserte : la genèse d’un escalier royal
Un architecte de Caserte à Madrid : Francesco Sabatini
Quatrième partie
CIRCULATION, ÉMULATION ET LÉGITIMATION
Chapitre VIII
L’escalier dans la culture architecturale européenne
L’expérience in situ
Le regard critique de l’architecte
Transmettre et rendre compte
À l’italienne, à la française
La spécificité du regard germanique
Les autres pays européens
La constitution d’une théorie de l’escalier
De l’Italie à la France
L’escalier dans les écrits en langue allemande : le rôle fondamental de Leonhard Christoph Sturm
Chapitre IX
L’escalier gravé : une diffusion ciblée
Les vues gravées en perspective : rendre les effets de volume de la cage d’escalier
Dessiner et graver des vues d’architecture : deux compétences distinctes
Mettre en perspective une cage d’escalier : point de vue et ligne d’horizon
L’importance des figures
Plans et coupes : diffuser le projet architectural
L’escalier du château de Berlin gravé par Jean-Baptiste Broebes
Le projet du palais de Caserte gravé sous la conduite de Luigi Vanvitelli
Le décor par parties
Plafonds peints
Figures isolées
Chapitre X
Paris et Rome : Des instances de conseil et de légitimation
Robert de Cotte : les conseils du premier architecte du roi de France
Balthasar Neumann à Paris
De la Bavière à l’Espagne
L’envoi des projets de l’escalier du palais royal de Madrid à l’Académie de Saint-Luc à Rome
Le modèle italien et l’Espagne des Bourbons : entre nécessité et magnificence
Annibale Scotti et la naissance d’un débat
Les conséquences de la consultation de l’Académie romaine
Conclusion
La splendeur de Versailles : un tournant de la dynamique somptuaire en Europe
Accueillir dignement et se distinguer
ANNEXES
ANNEXE I
Notices sommaires des principaux escaliers analysés
[E.1] Versailles, château de Versailles (Royaume de France)
[E.2] Londres, Kensington Palace (Royaume d’Angleterre)
[E.3] Dresde, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Saxe)
[E.4] Londres (Molesey), Palais de Hampton Court (Royaume d’Angleterre)
[E.5] Schleissheim, Château neuf de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.6] Berlin, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.7] Pommersfelden, château Weissenstein (territoire indépendant appartenant aux Schönborn)
[E.8] Dachau, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.9] Bonn, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Cologne)
[E.10] Brühl, Château d’Augustusburg (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Cologne)
[E.11] Mannheim, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat Palatin)
[E.12] Aranjuez, Palais d’ (Royaume d’Espagne)
[E.13] Ludwigsburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Duché de Wurtemberg)
[E.14] Munich, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.15] Bruchsal, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Spire)
[E.16] Madrid, Nouveau palais royal de (Royaume d’Espagne)
[E.17] Würzburg, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Würzburg)
[E.18] Charlottenburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.19] Vienne, Château de Schönbrunn (Saint‑Empire romain germanique, Cour impériale)
[E.20] Potsdam, Stadtschloss (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.21] Vienne, Hofburg (Saint-Empire romain germanique, Cour impériale)
[E.22] Fontainebleau, château de (Royaume de France)
[E.23] Caserte, Palais de (Royaume de Naples)
ANNEXE II
Sources comptables
Sources et bibliographie
Sources manuscrites
Allemagne
Autriche
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Sources imprimées
Ouvrages
Périodiques
Bibliographie
Index des noms
Index des lieux
Table des illustrations
Entre les années 1670 et 1760, les grands escaliers d’honneurs devinrent un espace d’apparat privilégié au sein des résidences princières européennes. Ils incarnaient à la fois le rang et les ambitions de leurs commanditaires. De Versailles à Caserta, de nombreux chantiers furent entrepris, dans un contexte diplomatique marqué par les rééquilibres politiques entraînés par la montée en puissance de la France de Louis XIV puis les guerres de succession d’Espagne (1701-1713), de Pologne (1733-1738) et d’Autriche (1740-1748). À partir d’un corpus original d’une trentaine d’escaliers bâtis pour des princes souverains en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en France et surtout dans le Saint-Empire romain germanique, cet ouvrage vise à mieux comprendre les contraintes et les enjeux qui ont présidé à leur production, en se fondant sur des sources en partie inédites. Pour la première fois, l’escalier est abordé tant sur le plan de l’architecture que du décor dans une perspective européenne qui donne un éclairage nouveau sur la compétition somptuaire entre les cours à l’époque moderne.
-
-

Table of contents / Table des matières – Zeina Hakim & Fayçal Falaky, « Avant-propos / Foreword » – Distance and Absorption / Distance et absorption – Nicholas Paige, « Still Lifes and Sublime Vistas: On the Non-Modernity of Diderot’s Approach to Genre Painting » ; Daniel Brewer, « Nature Time » ; Carole Martin, « La "Promenade Vernet", ou le paysage parlant » – Hermeneutics and the Signs of Nature / Herméneutique et signes de la nature – Lucien Nouis, « L’herméneutique paysagère du Voyage de Hollande » ; Servanne Woodward, « Le paysage : une nature à notre échelle » ; Andrew H. Clark, « Disrupting Genius: Dorval, landscape, and soliloquy » – Metaphysical Models / Modèles métaphysiques – Mitia Rioux-Beaulne « "Plus admirable que l’ouvrage de Dieu…". Modèle idéal contre belle nature dans le Salon de 1767 » ; Olivier Tonneau, « Aimer la nature en matérialiste : métaphysique, éthique et politique du paysage dans la "Promenade Vernet" » – Sensorial Landscapes / Paysages sensoriels – Philippe Sarrasin Robichaud, « Progresser par la méthode : la promenade dans les Leçons de clavecin (1771) » ; Clara de Courson, « Acoustique du paysage pictural : la trame sonore des Salons » ; Sarah Benharrech, « Diderot a-t-il une pensée pour le végétal ? Une lecture écocritique des Salons » ; Michel Delon, « Nature et industrie humaine. Le paysage, des Entretiens sur le fils naturel aux Essais sur la peinture ».
-

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
Définitions et méthodes
Une histoire littéraire de l’intérêt
CHAPITRE PREMIER
LE DISCOURS MÉTHODOLOGIQUE, 1750-1850
Le discours méthodologique dans l’histoire
Le « méthodologique » : une catégorie anachronique
Méthode, méthodologie : proposition de définitions
Le talent dans la méthodologie
Des préceptes discriminants
L’inégalité des observateurs
La méthodologie répond à cette inégalité
L’émulation : solution politique à la faillite de la preuve
L’observation : entre valeur et « stéréotypage »
Une faillite de la preuve
L’émulation comme solution politique
L’observation n’est pas scientifique
« L’esprit universel des sciences et des arts »
Unir lettres et sciences : un acte illocutoire
Conclusion
CHAPITRE II
L’OBSERVATION AU XVIIIe SIÈCLE
Une nouvelle individualité : l’observateur
Le génie observateur
L’original observateur
Le solitaire observateur
L’observateur contre le philosophe
L’observation et ses républiques
Les enjeux politiques de la méthodologie
« De différents observateurs », « Différence des esprits »
CHAPITRE III
LA RÉVOLUTION ET LE « MOMENT 1800 »
Persistances : l’exemple des institutions montpelliéraines
L’observation dans les allocutions institutionnelles
Une rhétorique de l’émulation
L’observateur dans la mêlée, de la Révolution à l’Empire
Intervenir en observateur
Moraliser l’observation
Un nouveau modèle : mérite, éducation, norme
Les instigateurs du nouveau modèle
Friction entre deux modèles
Conclusion : l’utopie en pratique
CHAPITRE IV
L’OBSERVATION À L’ÂGE ROMANTIQUE
L’observation dans le champ politique : libéraux, socialistes, individualisme
La Restauration : l’observation selon les libéraux
La monarchie de Juillet : observation et « individualisme »
L’observateur « malade du siècle »
Observation et distinction
La mode de l’observation dans les sciences et les lettres
« Fatiguer son génie à trouver des distinctions »
Vulgariser l’observation
Conclusion : paraître observateur
CHAPITRE V
L’OBSERVATION OBJECTIVE
L’objectivité met fin au génie observateur
Un contexte favorable : la photographie, la statistique
L’objectivité contre le génie observateur
L’observateur chez Claude Bernard
La reconversion de l’observation de soi
Introspection et observation de soi
S’observer : un nouveau détachement de soi
Une politique du moi
L’immoralisme de l’observation de soi
Conclusion : réflexivité, réciprocité
LA LITTÉRATURE RÉALISTE COMME MÉTHODOLOGIE
Le trait d’observation : une nouvelle valeur littéraire
L’observation dans la réception : tentatives d’approche
Valeur littéraire et valeur sociale
Le réalisme d’observation
Réalisme et empirisme : de l’obscurité à la transparence
Le réalisme sans la mimèsis
Omniscience, énigme, observateurs anonymes
Conclusion : un réalisme de la connivence sensible
CHAPITRE VII
DE LA MÉTHODOLOGIE AUX SCIENCES DE L’HOMME
Un indice du glissement épistémologique : la substituabilité
L’aveugle observateur
Le fou observateur
Le sauvage observateur
Une réinterprétation actuelle : l’observation participante
Généalogies de l’observation participante
Métempsycoses littéraires
Conclusion : le réel dans les sciences de l’homme
CONCLUSION
ÉVIDENCE ET MÉTHODE, DES OBJETS DE L’HISTOIRE
LITTÉRAIRE ?
BIBLIOGRAPHIE
INDEX
Scientifique, impersonnelle, désengagée : aucun de ces adjectifs ne convient à l’observation entre 1750 et 1850. Ce qu’on appelait alors l’« esprit d’observation » était un talent universel, dont l’existence menaçait le consensus scientifique. Dans la philosophie sensualiste, plus un individu est observateur, plus il se perfectionne au contact du monde : l’observation ne dévoile la vérité qu’en faisant diverger les esprits. Pour résoudre ce dilemme, la méthodologie se fit politique et nourrit une pensée contestataire, de la bohème littéraire du xviiie siècle aux socialistes du xixe. L’invention de l’objectivité finit par clore les débats, vers 1850, en annulant le génie d’observation au profit d’une substitution conventionnelle entre savants. Néanmoins, l’ancien schéma méthodologique se maintint dans la littérature réaliste. L’auteur observateur définit un réel commun à partir d’une négociation critique sur les talents. Cette littérature réaliste constitue donc une proposition épistémologique originale, qui interpelle encore nos sciences humaines.